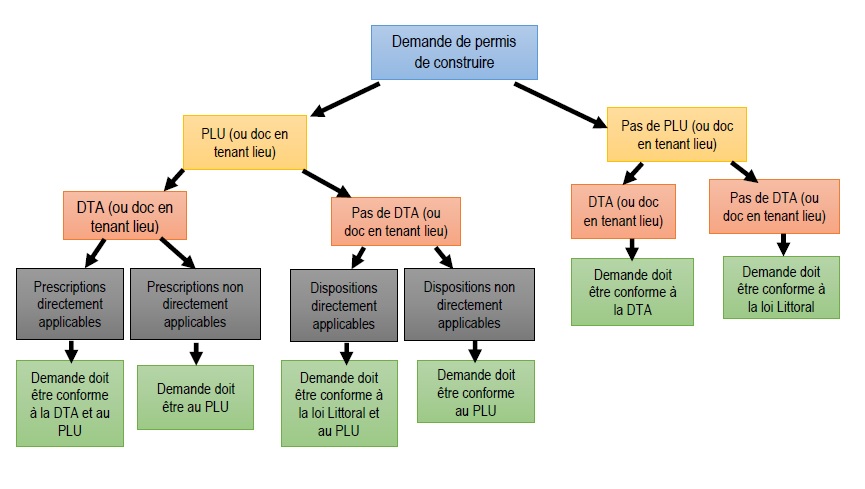Le référé suspension a ceci de particulier qu’il est un recours accessoire au recours en annulation ou en réformation. Les mesures que peut ordonner le juge du référé suspension sont par nature provisoires, jusqu’à l’intervention du jugement au principal. Dès lors précise le Conseil d’Etat dans sa décision Commune de Bordeaux (CE, 7 octobre 2016, n° 395211), il doit également en aller de même pour les décisions prises en exécution d’une décision rendue en référé. Les permis de construire délivrés à la suite de la suspension d’une décision de refus ne dérogent pas à ce principe. Qualifiés de provisoire, ils peuvent ainsi être retirés de l’ordonnancement juridique, sous certaines conditions, à la levée de la suspension de la décision de refus.
Adoptée par la section du contentieux du Conseil d’Etat, cette décision Commune de Bordeaux (CE, 7 octobre 2016, n° 395211)est très riche en enseignement et d’une particulière complexité en ce qu’elle fait intervenir tous les grands principes applicables aux actes administratifs. Intéressante donc, elle méritait bien une publication au Lebon et que l’on s’y attarde longuement.
*
*******
Commentaire de la décision CE, 7 octobre 2016, n° 395211, Commune de Bordeaux :
« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Bordeaux a, par un arrêté du 16 octobre 2013, refusé de délivrer à la société First Invest le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la construction d’une maison et d’un garage ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et a saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande de suspension de cet arrêté ; que, par une ordonnance du 7 mars 2014, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension et a enjoint au maire de Bordeaux d’instruire à nouveau la demande de permis de construire et de se prononcer sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ; que, par un arrêté du 28 juillet 2014, pris en visant cette ordonnance, le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société First Invest ; que, par une autre ordonnance du 5 août 2015, le président du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte à cette société de son désistement, enregistré le 10 juillet 2015, dans le litige au fond ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015, le maire de Bordeaux a, en conséquence, retiré le permis délivré le 28 juillet 2014 ; que, par une ordonnance du 26 novembre 2015, contre laquelle la commune de Bordeaux se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société First Invest tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi de la commune de Bordeaux :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : » Les jugements sont exécutoires » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; qu’aux termes de l’article L. 521-1 du même code : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu’aux termes de l’article R. 522-13 du même code : » L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) « .
3. Considérant, d’une part, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée ;
4. Considérant, d’autre part, que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu’il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; que, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus ; que lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ;
5. Considérant, enfin, qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; qu’il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande ; qu’eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative ;
6. Considérant que les règles rappelées aux points 3 à 5 sont notamment applicables aux décisions portant refus de permis de construire ; qu’en ce qui les concerne, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés ;
7. Considérant qu’un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire ; qu’un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus ; que cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l’objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond ; qu’elle ne peut en outre être prise qu’après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations ; qu’il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l’instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l’administration de la décision donnant acte du désistement ; qu’il en va également ainsi s’il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l’exercice d’une voie de recours contre la décision du juge des référés ;
8. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : » (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions, sur lesquelles s’est fondé le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2015 mettant fin au permis de construire provisoire délivré à la société First Invest, ne sont pas applicables au retrait, dans les conditions rappelées ci-dessus, d’un permis de construire délivré à titre provisoire ; que, par suite, la commune de Bordeaux est fondée à soutenir qu’en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Bordeaux est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la demande de référé de la société First Invest :
10. Considérant que la société Campistron-Sagardia, qui a acquis auprès de la société First Invest le terrain d’assiette sur lequel porte le permis de construire litigieux, et la société Lesa, qui a acquis ce même terrain auprès de la société Campistron-Sagardia, justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de la société First Invest ; que leurs interventions doivent, dès lors, être admises ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis provisoire délivré à la société First Invest méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, qu’il ne fait état d’aucune illégalité entachant le permis de construire délivré à titre provisoire et justifiant qu’il soit rapporté et, d’autre part, qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis prévu par ce même article, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, la demande de la société First Invest doit être rejetée ; «
*
********
Commentaire publié dans la revue JCP. A n° 15, du 18 avril 2017